COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Pile s'que j'disais. Presque.
Ne croyez pas tout ce que vous pensez.
T'facon l'acier c'est pas important du moment que c'est de l'acier. ASR.
T'facon l'acier c'est pas important du moment que c'est de l'acier. ASR.
-

baalot - Vis Versace
- Messages: 42377
- Inscrit le: 07 Nov 2014 13:46
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Z’etes des steel geeks… 
En fait, je note pas personnellement d’énormes écarts dans les aciers inox récents.
Mais à la réflexion, je ne crois pas avoir de CPM154…
J’ai testé le CTS XHP et le M4, comme acier de la technologie des poudres dernièrement, et c’est pas mal, mais ça va pas me faire lever la nuit pour aiguiser…
Du 14c28N me suffit amplement, et c’est de l’acier normal.
Si j’ai le choix, je prends un bluepaper, ou un 115w8, là, j’apprécie vraiment sur la pierre…

En fait, je note pas personnellement d’énormes écarts dans les aciers inox récents.

Mais à la réflexion, je ne crois pas avoir de CPM154…
J’ai testé le CTS XHP et le M4, comme acier de la technologie des poudres dernièrement, et c’est pas mal, mais ça va pas me faire lever la nuit pour aiguiser…
Du 14c28N me suffit amplement, et c’est de l’acier normal.

Si j’ai le choix, je prends un bluepaper, ou un 115w8, là, j’apprécie vraiment sur la pierre…

Ce couteau : comme icone, objet de discussion et signe de l'inutilité qui rend notre esprit heureux je te le conseille et pourqoui pas la vie est déjà triste et réaliste assez.
-

freddy1 - Jeb's Dîme
- Messages: 55201
- Inscrit le: 01 Nov 2006 19:29
- Localisation: sceaux
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Did a écrit:Dois-t-on faire le même traitement thermique?
Pas certain. D'une part comme la lame est structurellement plus solide il est peut être judicieux de viser une dureté plus importante. D'autre part, on doit essayer de préserver au maximum la distribution homogène initiale des carbures et donc probablement éviter les revenus à haute température.
Sur certains aciers, un revenu à haute température est utilisé pour atteindre un pic de dureté secondaire (si c'est le bon terme Français...)
Il me semble que c'est le cas pour le CPMD2, et j'ai lu le boss de LionSteel dire que c'était la méthode utilisée pour leur dernier fixe, en M390.
Je croyais que cette méthode permettait d'augmenter la dureté en conservant la résilience, tu penses que ça n'est pas toujours le cas?
j'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé.
mais j'ai la liste.
mais j'ai la liste.
-

Ghjallone - Maki Sushi Corse
- Messages: 8934
- Inscrit le: 18 Sep 2007 20:20
- Localisation: Corte, Corse
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
freddy1 a écrit:Z’etes des steel geeks…
En fait, je note pas personnellement d’énormes écarts dans les aciers inox récents.
Mais à la réflexion, je ne crois pas avoir de CPM154…
J’ai testé le CTS XHP et le M4, comme acier de la technologie des poudres dernièrement, et c’est pas mal, mais ça va pas me faire lever la nuit pour aiguiser…
Du 14c28N me suffit amplement, et c’est de l’acier normal.
Si j’ai le choix, je prends un bluepaper, ou un 115w8, là, j’apprécie vraiment sur la pierre…
Essayes le Vanadis10, tu va sentir une différence.

Plus sérieusement, perso c'est le S30V que j'adore. Surtout celui de CRK.
J'affute au papier de verre, tu ne fais la différence entre les aciers qu'avec une montre.
j'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé.
mais j'ai la liste.
mais j'ai la liste.
-

Ghjallone - Maki Sushi Corse
- Messages: 8934
- Inscrit le: 18 Sep 2007 20:20
- Localisation: Corte, Corse
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
A y est !!!! Le facebook pro est arrivé !!!
https://www.facebook.com/pages/Francois-Angelvy/232500670291688
https://www.facebook.com/pages/Francois-Angelvy/232500670291688
-
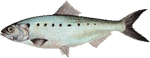
AGONE - Serbian Major
- Messages: 1608
- Inscrit le: 15 Fév 2011 21:40
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Bien sûr qu'il colle au sujet,il est top. 

Je m'empresse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer.Beaumarchais
-
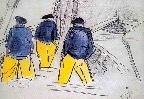
phd29 - regard de Breizh
- Messages: 15014
- Inscrit le: 06 Nov 2012 00:36
- Localisation: Konkerne finistère
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Ghjallone a écrit:Did a écrit:Dois-t-on faire le même traitement thermique?
Pas certain. D'une part comme la lame est structurellement plus solide il est peut être judicieux de viser une dureté plus importante. D'autre part, on doit essayer de préserver au maximum la distribution homogène initiale des carbures et donc probablement éviter les revenus à haute température.
Sur certains aciers, un revenu à haute température est utilisé pour atteindre un pic de dureté secondaire (si c'est le bon terme Français...)
Il me semble que c'est le cas pour le CPMD2, et j'ai lu le boss de LionSteel dire que c'était la méthode utilisée pour leur dernier fixe, en M390.
Je croyais que cette méthode permettait d'augmenter la dureté en conservant la résilience, tu penses que ça n'est pas toujours le cas?
Toujours d'après ce que j'ai compris (mais je ne suis ni coutelier ni métallurgiste) :
Un bon document de chez Uddeholm sur les aciers pour outils ici (p.10 et 12) : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= … 2s&cad=rja
Sur le D2 on a effectivement deux pics sur la courbe de revenue (typique des aciers inox), donc en théorie sur l'exemple ci-dessous on a la même dureté à 250 et 550°C :

D'une part, la courbe de revenue dépend de la température de trempe comme le montre ce schéma. D'autre part la dureté sera aussi fonction du traitement thermique avant le revenu (pour le cas du D2 : cryo ou non cryo).
On peut sauter l'explication longuette du passage suivant.
Le D2 c'est un acier utiliser pour les outils (Die steel n°2) qui existe depuis un moment. On cherchait donc à lui donner une résistance maximale pour cette application industrielle dans un temps où la trempe cryogénique n'existait pas (ou peu). Sans cryo lors de la trempe on avait plein d'austénite résiduelle, ce qui justifiait que systématiquement on utilisait le second pic de revenu afin de limiter l'austénite comme le montre le schéma.
Cela justifiait aussi un double ou triple revenu. Accessoirement les carbures étaient remis en solution à ces hautes températures et cela renforçait le coté "semi inoxydable". Cela permettait aussi de faire des traitements de surface de type nitruration qui renforçait la qualité de l'outil.
Voici un schéma typique du traitement industriel du D2 :
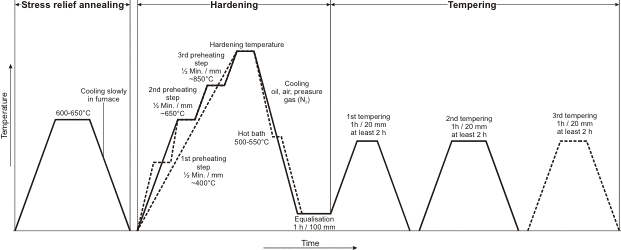
Pour une lame faites de façon traditionnelle : Sans traitement cryogénique, l'utilisation du pic de dureté secondaire (550°C) lors du revenu pour un couteau permettait d'augmenter la dureté (par transformation de l'austénite en martensite revenue) ce qui donne aussi une lame plus stable et plus solide dans la pratique (l'austénite ne risque pas de se transformer toute seule au cours du temps). Ce premier revenu devant être suivi d'un second revenu (pour stabiliser la martensite nouvellement formée). Tout ça c'est parfait pur un outil industriel et bien pour un couteau si on n'a pas accès à la cryo.
Pour arriver là.
De nos jours on peut faire un traitement cryogénique (évidemment c'est plus cher) qui va laisser bien moins d'austénite résiduelle à la fin de la trempe (qui est plus complète) que sur le schéma ci-dessus. Si on pratique après deux revenus (ou trois, encore plus cher) on élimine pratiquement totalement l'austénite et la lame n'est composée que de martensite transformée. La lame est un poil moins solide mais ça fait un meilleur couteau pour couper selon Roland Landes. Mais il y a débat.
Pour du CPMD2 : AMHA, moins on vient perturber la distribution des carbures, mieux c'est. Il me semble logique de faire une trempe cryogénique et deux ou trois revenus autour de 200/250°C. De ce fait on obtient une lame homogène, très dure et résistant bien à l'abrasion. Ce qui est l'objectif quand on utilise du CPMD2, par exemple pour vider plusieurs sangliers couverts de boue sans affiler la lame. Si on veut une lame très solide, on devrait prendre autre chose que du D2 ou du CPMD2.

Dernière édition par Did le 21 Sep 2016 16:47, édité 2 fois au total.
« … que celui qui n’a point d’épée vende son vêtement et achète une épée ».
-

Did - Messages: 271
- Inscrit le: 04 Avr 2008 18:21
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Ok, merci! 
j'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé.
mais j'ai la liste.
mais j'ai la liste.
-

Ghjallone - Maki Sushi Corse
- Messages: 8934
- Inscrit le: 18 Sep 2007 20:20
- Localisation: Corte, Corse
-

bibop83 - Messages: 868
- Inscrit le: 02 Aoû 2011 18:26
- Localisation: Nice, un peu dans le var aussi
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX

Je l'ai essayé ce soir rapidement le Bowie de thomas Rucker, coupe a la volée, il est top, pour chopper avec le poids c'est top.La poignée cuir est hyper agreable et amortit bien l'impact.
Bref content je suis.
Je m'empresse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer.Beaumarchais
-
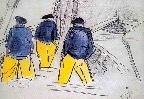
phd29 - regard de Breizh
- Messages: 15014
- Inscrit le: 06 Nov 2012 00:36
- Localisation: Konkerne finistère
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Content tu peux 

-

Gael - Messages: 134
- Inscrit le: 28 Aoû 2012 06:48
- Localisation: Lille
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Ouch ! On se dit: il a l'air grand ce couteau !
Puis quand on voit le manche tout mini à droite, on réalise qu'il doit être ENORME en fait !!!
Puis quand on voit le manche tout mini à droite, on réalise qu'il doit être ENORME en fait !!!

-

Jonathan P. - David Schiffer
- Messages: 32111
- Inscrit le: 11 Avr 2009 10:41
- Localisation: Bruxelles
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Comme Jo. Le tien Brady ? Ça se chope où comment un Desrosiers ?
100% Artisanat Français • Faut qu'ça vive ! • Membre de l'Amicale du Djouk
-

Lipsum - vautour de contrôle
- Messages: 17839
- Inscrit le: 17 Mar 2010 16:32
- Localisation: Ais de Prouvènço
Re: COUTEAUX DE CAMP/GRANDS COUTEAUX
Jonathan P. a écrit:Ouch ! On se dit: il a l'air grand ce couteau !
Puis quand on voit le manche tout mini à droite, on réalise qu'il doit être ENORME en fait !!!
125 mm un peu court pour moi …
-

brady barr - Dr Jekyll
- Messages: 5101
- Inscrit le: 22 Fév 2011 09:50
- Localisation: region parisienne
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités




